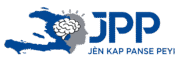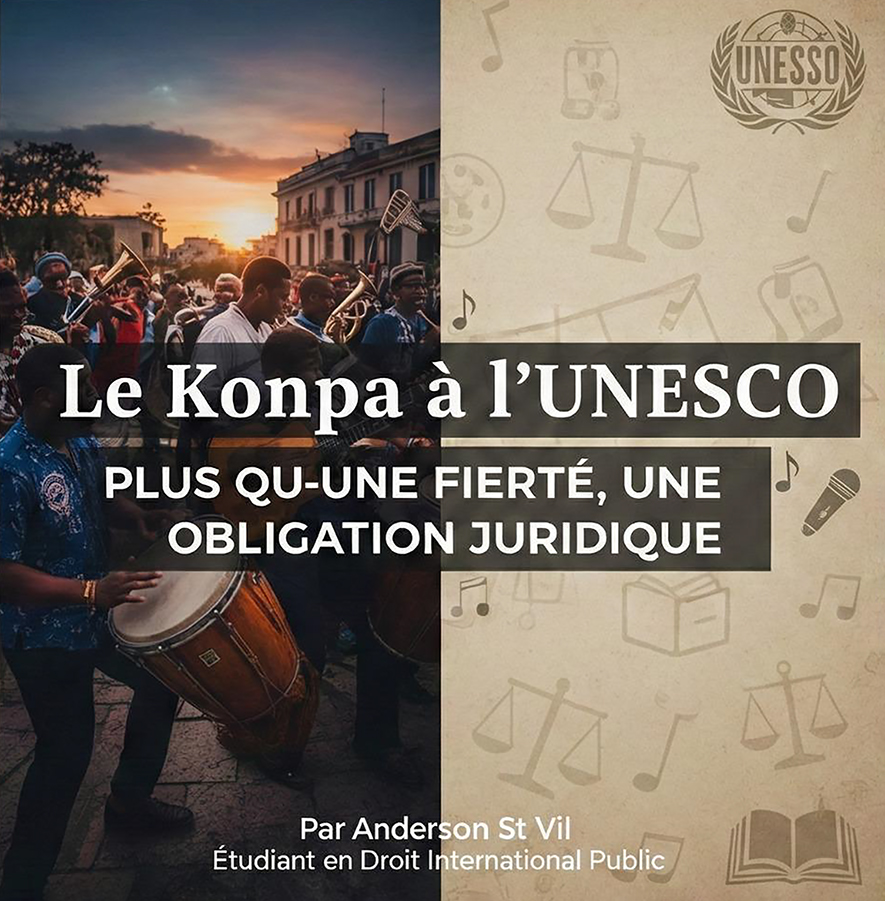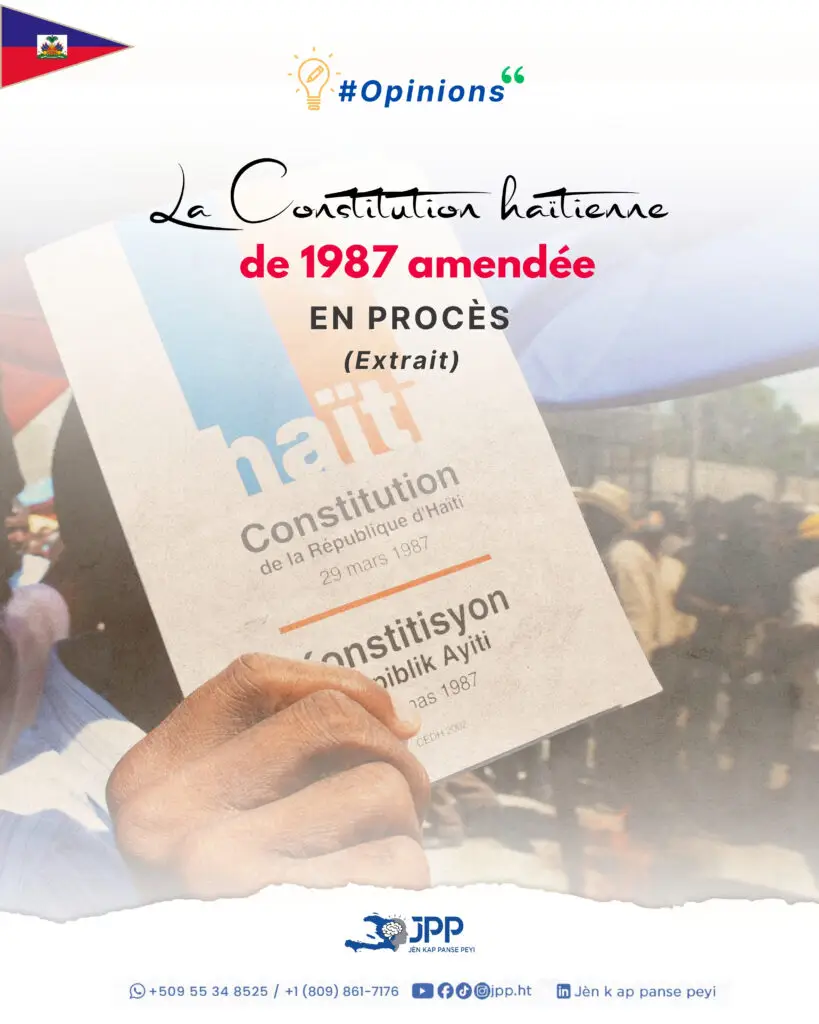Nombreux sont ceux qui pensent aujourd’hui que la Constitution haïtienne de 1987 serait déjà essoufflée, voire en déphasage par rapport à de nouvelles réalités socio-politiques qui exigeraient que la volonté constituante soit à nouveau exprimée. Nous pensons qu’il y a deux façons d’aborder cette question. D’abord, d’un point de vue purement constitutionnaliste, il est flagrant que le système de répartition des pouvoirs est foncièrement conflictuel. En effet, en décidant de ne pas mettre en place les mécanismes d’un strict équilibre des pouvoirs, les constituants ont trop misé sur le jeu politique. Sachant que celui-ci ne peut s’empêcher de les mettre en compétition de façon à ce que l’un cherche constammentà nuire à l’existence de l’autre. Ensuite, politiquement, on ne saurait dire que nos acteurs, nos élus, se sont toujours montrés enclins au respect de la lettre de la constitution. Mentionnons entre autres les pratiques de marchandage, les soupçons de corruption quand il s’agit pour l’exécutif et le législatif de collaborer afin d’investir dans ses fonctions un chef de gouvernement ; la réticence de l’exécutif quand il est question d’organiser les élections dans les délais prescrits ; la propension malicieuse de l’exécutif à profiter des périodes transitionnelles pour légiférer par décret… A croire que le problème proviendrait davantage de l’application de la constitution que de son applicabilité. Dans ce procès de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987, il serait inconvenable et négligent de notre part si on se refusait le droit de pointer du doigt l’illusion des constituants au sujet de ce que seraient nos honorables députés et sénateurs du peuple, voire de la politique haïtienne en général. Nous imaginons qu’en proclamant une telle suprématie de l’AN, ils avaient en tête l’image d’un parlement guidé par une logique de parti : tel parti majoritaire guide l’Assemblée pendant un certain temps sans remettre en cause l’existence de l’autre ou des autres, le temps que ceux-ci puissent à leur tour prendre les rênes. Mais au fil du temps, la réalité est tout à fait autre. Nous avons plutôt à faire à une kyrielle de partis qui s’apparentent davantage à des factions, incapables pour la plupart de proposer un projet de société ou de se forger une identité. Comme conséquence directe, le vote du peuple est la plupart du temps fragmenté, le principe majoritaire devient une idylle. Cette « pénurie de majorité » associée à un peuple peu cultivé politiquement ne fait que compliquer l’application effective de la Constitution et remettre en cause la démocratie même en Haïti. […] Tout compte fait, nous voulons terminer ce travail en abordant la question de la réforme ou du changement de constitution qui maintient depuis quelques temps l’actualité en haleine. Précisons d’emblée que la première et principale différence entre « amender » et « changer » de Constitution tient au fait que chacun fait appel à un type de pouvoir spécifique. Alors que celui-ci fait intervenir le pouvoir constituant originaire, celui-là fait intervenir le pouvoir constituant dérivé. Comme son nom l’indique, ce dernier dérive et tire sa légitimité du pouvoir constituant originaire car il est toujours institué dans la lettre de la Constitution. En d’autres termes, il revient au pouvoir constituant originaire d’instituer le pouvoir constituant dérivé ou de prévoir les mécanismes de réforme ou d’amendement de la Constitution. Par exemple, dans le Titre XIII de la Constitution, il est explicitement prévu le mécanisme par lequel celle-ci peut être modifiée. Le pouvoir constituant dérivé qui est établi et reconnu c’est l’Assemblée Nationale, et ceci de façon souveraine car elle n’a pas besoin de consulter le peuple pour s’y prendre. Il suffit d’avoir l’adhésion et le vote positif d’au moins 2/3 des membres des deux chambres, avec un quorum de 2/3 au moins des membres présents. Il va donc sans dire que toute la complexité de la situation actuelle revient surtout au fait qu’il n’y a aucune législature en cours pendant cette période de transition. Afin de profiter de ce moment de sursis constitutionnel, plus d’un s’accrochent à l’idée de faire d’une pierre deux coups : changer de constitution avant que des élections générales ne s’organisent dans le pays. Cependant, nous pensons qu’il n’est pas du tout l’heure de se livrer à l’euphorie. Cela est-il suffisant pour faire appel au pouvoir constituant originaire ? Le pouvoir constituant originaire est un pouvoir qui intervient généralement dans un contexte d’absence de constitution ou de vide juridique. Celui-ci, s’il ne s’auto-crée sous l’action de l’ordre naturel des choses, est le plus souvent voulu par toutes les forces d’un corps social ou d’une communauté humaine. Deux exemples. En 1804, la République d’Haïti est proclamée au prix d’une sanglante conquête d’indépendance par les armes. L’éradication des français sur l’ile fut accompagnée de celle du droit colonial également. Par conséquent, dans la vie juridique de Saint-Domingue ce qui en restait ce fut un vide total. Voilà pourquoi en 1805, Dessalines mit en exécution le pouvoir constituant originaire pour doter le pays de sa première Constitution. Autre exemple, après la chute de Jean-Claude Duvalier, toutes les forces vives de la nation, de la classe politique à la société civile, ont manifesté leur volonté de faire table rase de l’ordre juridique existant. On a effectivement fait le vide, puis le plein avec la Constitution qui est en procès aujourd’hui. Certes, « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution, une génération ne pouvant assujettir à ses lois les générations futures » . Mais la question idoine est de nous demander si cette Constitution de 1987 est oppressante ?